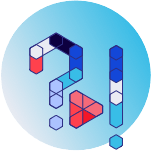Fake news : comment éviter les pièges ?
Si la propagation de rumeurs et d’informations trompeuses a toujours existé, elle a pris ces dernières années une ampleur préoccupante sur internet. Dans un contexte géopolitique agité, la propagation de fake news a été multipliée par 34 entre septembre et novembre 2023 sur les plateformes sociales en France, selon une étude Onclusive-Digimind. Comment repérer les infox ? Quels sont les signes qui doivent vous alerter ? Quels moyens permettent de vérifier l’authenticité d’une image ou d’une information ? On fait le point !
Fake news, désinformation, mésinformation : de quoi parle-t-on ?
En anglais, l’expression « fake news » signifie « fausse information ». On lui préfère parfois en français le mot « infox » (contraction de « info » et « intox »). Souvent repérables par des phrases accrocheuses qui incitent au clic, comme « La vérité sur… » ou « Ce qu’on ne vous a jamais dit sur… », les fausses informations sont généralement produites et diffusées pour manipuler une audience ou pour accroître le trafic d’un site, média ou compte sur les réseaux sociaux.
Les fake news font donc partie d’une entreprise de désinformation qui peut être mise en œuvre à grande échelle, en relayant des informations délibérément fausses et trompeuses pour influencer l’opinion publique sur un sujet donné. Cela peut notamment être le fait d’un État, comme le « doppelgänger », l’opération d’ingérence numérique menée par la Russie à l’encontre des alliés de l’Ukraine, ou d’une entreprise qui voudrait redorer son image ou cacher des mauvaises pratiques, en les noyant sous un flot de contenus plus positifs ou en attaquant d’autres acteurs.
La mésinformation, elle, constitue une zone grise où l’on publie ou relaye une information fausse ou inexacte de façon non-intentionnelle. Cela peut par exemple être le cas d’un journaliste qui a manqué de vigilance, ou d’un influenceur qui s’est laissé séduire par une histoire trop belle pour être vraie.
Les images aussi peuvent tromper
Pour les images et l’audiovisuel, deux cas de figure se distinguent :
- des images, vidéos ou reportages mensongers en eux-mêmes, soit parce qu’ils tordent les faits, soit parce qu’ils sont truqués (photomontages, vidéos ou propos tronqués…), soit encore parce qu’il s’agit de contenus générés à l’aide de l’intelligence artificielle (IA).
- des images détournées et sorties de leur contexte. On peut ainsi faire croire aux internautes qu’un cliché a été pris lors d’un événement d’actualité récente, alors qu’il date en réalité de plusieurs années et représente tout à fait autre chose.
Où sont diffusées les fake news ?
Les réseaux sociaux en tête
Les réseaux sociaux sont l’un des espaces privilégiés de diffusion et de propagation des infox. Selon un sondage Odoxa Dentsu-Consulting pour franceinfo et Le Figaro, 45 % des Français qui s’informent principalement via les réseaux sociaux reconnaissent avoir déjà relayé des fake news. Tandis que d’après l’European Digital Media Observatory, 40 % des sujets de désinformation sont diffusés par l’intermédiaire de Facebook.
Si ces réseaux sont visés en priorité par les acteurs mal intentionnés qui créent des fake news, c’est parce qu’il s’agit d’espaces d’expression libre, facilement accessible à tous, où chacun est non seulement spectateur, mais aussi producteur de contenus. Mettre en ligne des infox qui, via les algorithmes qui favorisent souvent les posts les plus sensationnalistes, vont se propager plus vite que de vraies informations est presque un jeu d’enfant. Il suffit de la complicité de quelques comptes influents pour que la fake news devienne virale.
Ces dernières années, la période du Covid-19 a été particulièrement propice à l’émergence de fake news. Vous vous rappelez sans doute l’idée complotiste selon laquelle le réseau de téléphonie 5G contribuerait à propager le virus… et de son pendant, qui voudrait que les vaccins contiennent des micropuces destinées à ficher la population.
Le code européen de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation
Ce code mis en place en 2022 s’appuie sur le code pionnier de 2018 par lequel les acteurs de l’industrie numérique se sont mis d’accord sur des normes d’autorégulation pour lutter contre la désinformation.
Dans sa version de 2022, les signataires s’engagent à mieux coopérer avec les fact-checkeurs et à priver de publicité les sites diffusant des infox.
S’il est loin d’être un rempart absolu contre les fake news, ce code constitue pourtant un pas dans la bonne direction, signe de bonne volonté des acteurs qui l’ont signé. C’est le cas notamment de Meta, Google, Twitter, Microsoft, TikTok, d’autres plateformes plus modestes, de professionnels de la publicité, de « fact-checkeurs » et d’organisations non gouvernementales (ONG).
En mai 2023 Elon Musk, propriétaire de Twitter devenu X, s’est retiré du code et a limogé une grande partie des équipes dédiées à la modération et aux questions éthiques sur son réseau.
Mais pas seulement…
Certains médias ou certaines personnalités peuvent également diffuser des infox tout aussi dangereuses, sinon davantage, car revêtant les attributs d’un travail sérieux.
Souvenez-vous du cas récent du film Hold Up , qui a connu un certain succès dans sa diffusion d’idées complotistes au sujet du Covid-19 et de la gestion de la crise sanitaire. L’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont visionné ce soi-disant documentaire tient au profil du réalisateur, Pierre Barnérias, journaliste et ex-collaborateur de médias reconnus comme France 3 ou Arte.
La plupart des grands médias, qui effectuent un travail journalistique obéissant à des règles de déontologie strictes et qui vérifient et sourcent toutes les informations qu’ils publient, ont créé des cellules dites de « fact-checking ». Leur travail consiste à vérifier les allégations qui circulent sur le web ou ailleurs, pour se prononcer sur leur véracité ou non, et le cas échéant, rétablir les faits.
Les « fact-checkeurs » mènent un travail d’enquête journalistique rigoureux, en interrogeant différentes sources comme les pouvoirs publics, experts, témoins, afin de recouper les informations, et de séparer les opinions des faits. C’est notamment le cas du service des Décodeurs du journal Le Monde, qui a repris le documentaire Hold Up pour mettre à jour ses nombreux mensonges et arrangements avec la vérité.
Qui produit les fake news, et dans quel but ?
Même si cela devient de plus en plus facile, notamment avec la montée en puissance de l’IA et la viralité des réseaux sociaux, produire une infox crédible et bien construite demande du temps et des moyens. De tels contenus sont donc rarement diffusés sans un but précis.
L’ancien président américain Donald Trump est un cas d’école en la matière, à l’instar de l’expression « You are fake news ! » qu’il avait lancé à l’encontre du média de référence CNN lors de sa toute première conférence de presse post-élection.
Au-delà de ce cas spécifique, des agences dédiées spécifiquement à la production et à la diffusion de fake news ont vu le jour ces dernières années. Souvent discrètes et inconnues du grand public, elles forment une véritable industrie de la désinformation, qui vend du « blanchiment narratif » à ses clients. Parmi ces derniers : des personnalités voulant faire oublier des révélations gênantes, des entreprises souhaitant masquer leurs pratiques immorales ou attaquer un concurrent, ou encore des États désireux d’influer sur la vie politique d’autres régimes ou bien souhaitant améliorer leur propre image.
Que dit la loi ?
Au niveau européen, après le code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation, un nouveau règlement sur les services numériques baptisé Digital Services Act (DSA) est entré en vigueur en août 2023. Celui-ci vise à encadrer les activités des plateformes, et en particulier celles des GAFAM. L’objectif principal est de limiter la propagation des propos haineux, des fake news, des ingérences dans les élections, des atteintes à la dignité humaine ou aux mineurs.
Pour cela, plusieurs décisions fortes ont été prises :
- les plateformes doivent désormais informer leurs utilisateurs du fonctionnement des algorithmes qu’elles utilisent ;
- les données dites « sensibles » (origine ethnique, opinions politiques, orientation sexuelle) ne doivent plus être utilisées pour le ciblage publicitaire ;
- le signalement de contenus considérés comme « illicites » doit être facilité, et les plateformes doivent traiter rapidement les signalements, et répondre aux réclamations des utilisateurs ;
- la mise en place de « signaleurs de confiance », désignés par les régulateurs nationaux (en France, l’Arcom) : leurs notifications seront traitées en priorité, comme c’est le cas pour la plateforme Pharos, lancée par le gouvernement français.
Comment reconnaître les fake news ?
Voici quelques conseils généraux pour débusquer les infox…
- Faites attention aux sources : demandez-vous toujours qui a écrit l’article ou le message que vous êtes en train de lire. Quels sont les éléments objectifs (déclarations publiques, éléments authentifiés, études scientifiques…) derrière les allégations ? Pouvez-vous remonter à la source de ces documents, et vous faire un avis de première main ?
- Soyez attentif au support : l’article émane-t-il d’un journaliste professionnel, travaillant dans un média dont le sérieux est reconnu ? D’un site institutionnel, lié aux pouvoirs publics et digne de confiance ? Du blog d’un expert qui a travaillé sur le sujet ? Ou bien est-ce au contraire un blog d’opinion qui par définition prend parti ? Voire d’un site obscur, dont vous n’avez jamais entendu parler ?
- Réfléchissez à l’objectif : distinguez-vous des motivations claires dans la diffusion de cette supposée information ? Si vous pouvez identifier clairement l’auteur, celui-ci a-t-il intérêt à orienter les faits dans un sens ou dans un autre ? Si le contenu est anonyme, est-ce justement parce qu’il répond à un objectif douteux ? Enfin, vérifiez que vous n’êtes pas tout simplement sur un site parodique, dont le but serait… de vous divertir.
- Observez la forme : comment le message, l’article ou la vidéo se présentent-ils ? Le titre reflète-t-il bien le contenu ? Le propos et sa tonalité vous paraissent-ils mesurés, ou bien y a-t-il un excès manifeste d’enthousiasme ou au contraire de réprobation ?
Vérifiez toujours si le site est sécurisé. Y a-t-il des publicités douteuses et en grande quantité ? Quels sont les autres contenus qui y figurent, et paraissent-ils sérieux ? Y a-t-il une page de présentation claire qui indique son ou ses auteurs, ainsi que les mentions légales obligatoires ?
Plus largement, pour les sites qui se présentent comme des médias d’information ou des sources institutionnelles, la forme vous semble-t-elle sérieuse et officielle (mise en page, orthographe, graphisme, etc.) ? Si vous créez vous-même un site, prenez garde à ces aspects qui peuvent changer radicalement la façon dont les internautes perçoivent vos contenus. - Lisez quelques commentaires : si l’article ou le message suscite des discussions auprès des internautes, il peut être utile de regarder rapidement ce qui en a été dit. Confirment-ils l’information donnée, ou au contraire renvoient-ils vers une source de fact-checking qui la contredit ? Attention toutefois, les commentateurs eux-mêmes ne sont pas toujours des sources fiables (faux profils, personnes elles-mêmes victimes de fake news…).
- Vérifiez ce qu’en disent les autres sites : d’autres sources abordent-elles le même sujet ou la même information ? Qu’en disent-elles ? Quel support a la meilleure e-réputation et vous semble le plus fiable ?
Comment repérer les fausses images ?
Vous avez peut-être vu passer l’image désormais célèbre du Pape François portant une doudoune : aussi virale qu’elle ait été, elle n’en demeure pas moins fausse. Ces dernières années, dans un monde numérique où images et vidéos circulent de plus en plus vite, l’émergence d’outils d’IA accessibles et performants a elle aussi accéléré la production de contenus visuels trompeurs.

1. Regardez bien l’image
Prenez le temps d’analyser, de vous attarder sur les détails, de zoomer pour repérer d’éventuels filigranes, des montages grossiers ou des incohérences typiques des images créées par l’intelligence artificielle.
2. Consultez la presse
Assurez-vous que cette image/vidéo a été relayée par des sources fiables. Par exemple des médias reconnus comme l’Agence France Presse, Reuters, Franceinfo, Libération, Sud-Ouest, L’Obs, etc.
3. Vérifiez par qui la photo ou la vidéo a été prise, quand et où elle a été publiée
L’astuce : Google propose la fonctionnalité recherche inversée.
Faites un clic droit sur votre image et sélectionnez : « Rechercher l’image avec Google ». La page de résultats affichera la taille de l’image, quand et où elle a été publiée.
Parmi nos conseils pour ne pas vous faire avoir :
- Regardez bien les images en question : prenez le temps d’analyser, attardez-vous sur des détails (l’IA a encore des difficultés à générer des mains réalistes comportant le bon nombre de doigts par exemple), au besoin zoomez, essayez de repérer les filigranes, voire les montages plus grossiers.
- Vérifiez par qui la photo ou la vidéo a été prise, quand et où elle a été publiée : de la même manière que pour un article ou un message, comme expliqué précédemment.
- Faites une recherche inversée : certains navigateurs proposent, via un clic droit sur l’image, une option de recherche automatique sur un moteur de recherche. Les résultats vous indiqueront si elle a été publiée ailleurs sur le web, et dans quel contexte.
- Prêtez attention aux relais : vérifiez si cette image ou cette vidéo ont été relayées par des médias ou des personnes fiables, que vous identifiez ou connaissez.
S’il est vrai qu’internet, et en particulier les réseaux sociaux, tiennent parfois de la jungle informationnelle où le meilleur côtoie le pire, ces quelques réflexes peuvent vous permettre de vous y retrouver. Pour ne pas tomber dans le piège, ne croyez pas d’emblée ce qui vous semble être trop beau ou trop incroyable, et vérifiez bien la provenance et les sources de vos informations !
Article rédigé par les experts du .fr